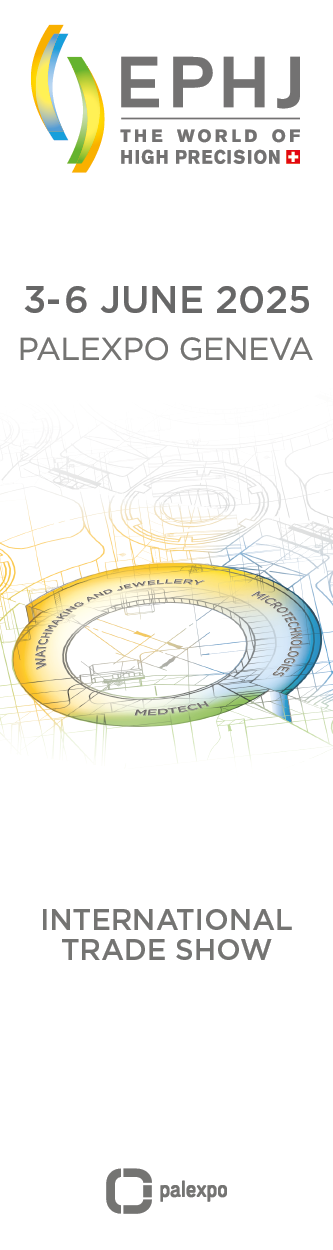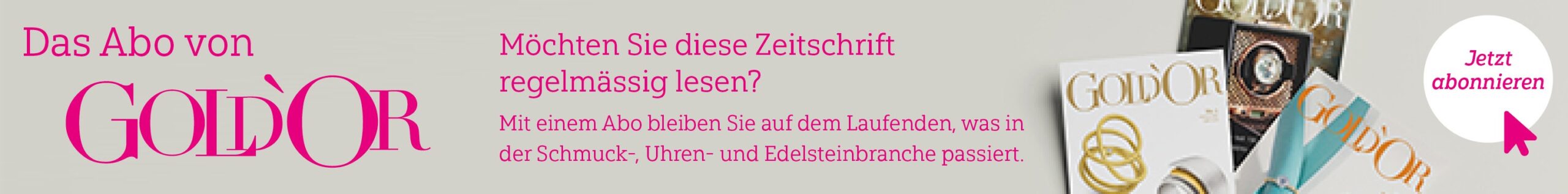L’homme rêve depuis longtemps de machines qui lui ressemblent. Les automates du XVIIIe siècle annoncent nos préoccupations modernes et constituent des formes d’intelligence artificielle avant l’heure.
Pas un jour ne passe sans que l’intelligence artificielle (IA) ne fasse la une, tantôt encensée pour ses avancées, tantôt pointée du doigt pour ses dérives potentielles. Qu’on les apprécie ou qu’on s’en méfie, les chatbots et autres robots conversationnels s’imposent désormais dans notre quotidien. L’IA est en train de redéfinir en profondeur notre rapport aux machines et les usages que nous en faisons.
L’idée d’une machine capable d’imiter l’humain et de fonctionner de façon autonome n’est pas récente. Elle puise ses racines dans l’Antiquité grecque. Le mot «automate» vient en effet du mot grec «automatos», qui signifie «agir de sa propre volonté». Depuis des siècles, ingénieurs et inventeurs cherchent à insuffler une illusion de vie à des objets mécaniques, fascinant le public par des dispositifs dont la prouesse technique étonne autant qu’elle divertit.

La fascination pour les androïdes
Un siècle en particulier s’est illustré dans l’art de la mécanique animée, celui des Lumières. À cette époque, les élites sociales et intellectuelles nourrissent une fascination marquée pour les sciences et les techniques. L’automate devient alors bien plus qu’un simple objet de divertissement: il se transforme en outil d’expérimentation sur le vivant. Une question centrale anime les esprits scientifiques et philosophiques: les fonctions vitales du corps humain et animal sont-elles de nature mécanique?
Pour y répondre, on s’attelle à reproduire des processus physiologiques complexes comme la voix et la digestion à travers la construction d’automates toujours plus sophistiqués. Simuler avec précision les gestes humains nécessite un haut niveau de connaissances médicales et de maîtrise technique. C’est ainsi que le savoir-faire horloger, avec ses cames et ses rouages minutieusement agencés, se fait un allié de ces recherches.
Le premier inventeur à s’engager en ce sens est Jacques Vaucanson. À la fin des années 1730, il présente à Paris trois automates de grandeur nature: un Canard qui digère ce qu’il mange, un Joueur de Tambourin et un Joueur de flûte. Cette pièce est la plus novatrice. Elle ne produit pas de sons via une boîte à musique cachée dans le socle, mais joue véritablement de l’instrument. Les doigts du personnage se déplacent sur les trous de la flûte et se synchronisent avec le mouvement des lèvres, de la langue et la mâchoire inférieure, alors que le tout est animé par un système intriqué de cames et de sifflets contrôlant le flux d’air. Le succès du trio est immédiat et inspire l’apparition du mot «androïde» dans le premier volume de l’«Encyclopédie» de Diderot et d’Alembert. Vaucanson ira même jusqu’à promettre la création d’un automate reproduisant la circulation sanguine grâce au caoutchouc, un projet aussi ambitieux qu’irréalisé.

Les automates Jaquet-Droz
Si les machines de Vaucanson ont disparu, leurs célèbres rivales ont traversé les siècles. Les automates Jaquet-Droz sont aujourd’hui conservés au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Ils sont construits à La Chaux-de-Fonds entre 1768 et 1772 dans l’atelier du pendulier Pierre Jaquet-Droz, qui travaille en collaboration avec son fils Henry-Louis et son associé Jean-Frédéric Leschot. Ils forment une famille mécanique, composée d’un Écrivain, d’un Dessinateur et d’une Musicienne.
L’Écrivain, conçu par Pierre, peut rédiger n’importe quel texte de 42 caractères. Son mécanisme, programmable à l’infini, fait de lui l’ancêtre évident de nos formes d’intelligence artificielle. Le Dessinateur exécute quatre dessins à choix avec une étonnante fluidité. Quant à la Musicienne, dotée d’un système de respiration autonome d’une heure, elle joue huit airs différents en bougeant ses doigts sur les touches. Cette dernière et le Dessinateur sont l’œuvre d’Henry-Louis.
Pendant des décennies, cette famille mécanique émerveille l’Europe entière. Au-delà de leur prouesse technique, les automates sont également d’excellents outils de promotion commerciale et font donc des émules: l’écrivain-dessinateur d’Henry Maillardet, les têtes parlantes de l’abbé Mical, ou encore le joueur d’échecs de Wolfgang von Kempelen, capable d’affronter, dit-on, Benjamin Franklin. On découvrira plus tard que ce dernier cachait un homme dissimulé dans la table de jeu, manipulant les gestes de l’androïde.
Dès lors, les automates entretiennent l’ambiguïté sur les limites qui séparent le visible de l’invisible, l’illusion de la vérité et le connu de l’inconnu. Les Jaquet-Droz, par exemple, se servent de cette ambivalence, en laissant croire que l’Écrivain est mû par des forces magiques et magnétiques, sans doute aussi pour protéger les secrets de sa fabrication.
Derrière la fascination qu’il suscite, l’androïde des Lumières rappelle toutefois au spectateur qu’il doit garder sa vigilance face à la machine pour s’assurer de ne pas se laisser tromper. Ainsi, pour les écrivains et les philosophes de cette période, l’automate soulève une question primordiale, celle de la liberté individuelle. C’est dans cet aspect, affirment-ils, que réside la différence fondamentale entre l’homme et la machine. Les cames ont beau reproduire l’humain le plus parfaitement possible, elles ne sont pas dotées d’esprit, ni de conscience, ni de la capacité à effectuer des choix moraux.
À ce titre, la Révolution française nous a légué une proposition originale. En 1791, le mathématicien et philosophe Nicolas de Condorcet imagine une monarchie mécanique, composée de 250 androïdes qui substitueraient les membres de la famille royale, de la noblesse, etc. Certes, concède-t-il, l’investissement initial serait conséquent, mais les économies à moyen terme seraient considérables: peu d’entretien, et surtout, une garantie précieuse (si le roi ou la reine venaient à manquer de raison, il suffirait au peuple de leur changer de tête). Face à notre monde contemporain, l’idée de Condorcet semble avoir conservé toute son actualité.
Rossella Baldi